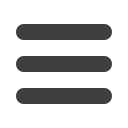
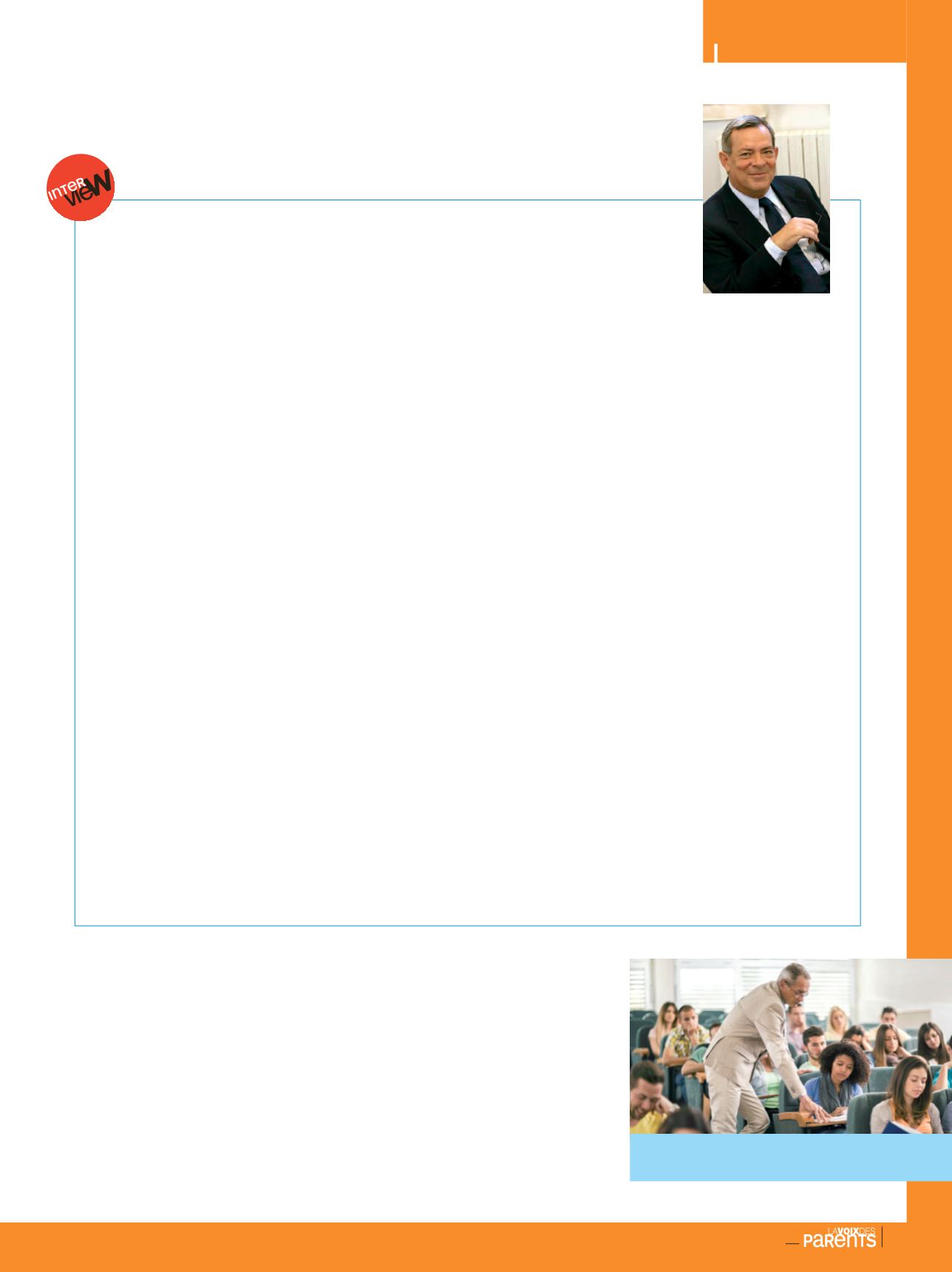
DOSSIER
ENSEIGNANTS : COMMENT SONT-ILS FORMÉS ?
méthodes et pratiques de l’enseigne-
ment, alors que les deux années,
dans les IUFM, servaient à préparer le
concours.
Relation aux familles
En outre, les ESPE ont rétabli l’alter-
nance dans la formation des ensei-
gnants, supprimée en 2010. Ainsi, en
M2, les étudiants sont en fait des sta-
giaires et combinent d’un côté douze
concours de recrutement des enseignants
sont essentiellement portés sur les savoirs disci-
plinaires, laissant une place marginale aux
questions de pédagogie et de didactique.
« Or, si le concours se base sur les disciplines,
les cours dans les ESPE aussi car les écoles
menant au métier d’enseignant ont pour but
la réussite de leurs élèves, donc leur réussite
au concours »
, relève Jacques Ginestié. Avec
les ESPE, si le M1 reste logiquement centré sur
la préparation du concours, de nombreux
modules de M2, en revanche, concernent les
www.peep.asso.fr- numéro 390 - Mars-avril 2016
21
(suite page 22)
Claude Lelièvre,
historien de l’éducation
Peut-on dater le début de la formation des
enseignants ?
A la fin du XVIII
e
siècle et première partie du XIX
e
, les
enseignants étaient formés dans des congrégations, de
petits centres mobiles, sortes de frères des écoles
chrétiennes. Mais ce n’est pas institutionnalisé. Il faut
attendre la loi Guizot de 1833 pour voir la généralisation
de la formation des enseignants du primaire, au sein des
écoles normales. C’est l’institutionnalisation d’une
formation académique et professionnelle.
Pour le secondaire, même s’il y avait l’Ulm dès la fin du
XIX
e
, la formation commence dans les années 1960 avec
les CPR (centres pédagogiques régionaux) et la création
du CAPES.
Quelles évolutions ces formations ont-elle
connues ?
Il y a eu un double mouvement. D’abord,
l’ « universitarisation » de la formation des enseignants
du primaire qui a décentré leur formation des écoles
normales. Petit à petit, le niveau de recrutement des
instituteurs s’est élevé : du bac, il est passé au DEUG
dans les années 1970 puis à la licence, à la fin des années
1980.
Le deuxième mouvement souhaitait former les
enseignants du secondaire plus professionnellement. Ces
deux mouvements conjugués ont amené la création des
IUFM, en 1990.
Qu’étaient alors ces Instituts universitaires de
formation des maîtres ?
Les enseignants du primaire avaient une formation
davantage portée sur la didactique et ceux du secondaire
sur la discipline académique. Les IUFM devaient alors
rapprocher les deux formations. On voit dans le sigle le
but de ces IUFM, avec à la fois les mots « université » et
« maîtres ». On voulait plus de formation académique,
disciplinaire et donc universitaire pour le primaire, et
plus de didactique, de pédagogie, pour le secondaire.
Mais ça ne s’est pas fait sans mal, car il fallait que se
rencontrent deux mondes très différents. Mais là était le
but : rapprocher les deux corps au niveau des statuts, des
rémunérations et donc de la formation.
Les ESPE (Ecoles supérieures du professorat et de
l’éducation) sont-elles finalement la suite logique à
toute cette histoire de la formation des
enseignants ?
Elles sont une évolution. Leur mise en place s’avère
difficile car il a en quelque sorte fallu recréer les IUFM,
liquidés sous Nicolas Sarkozy. On est même allé plus loin,
en les intégrant dans les universités. Le changement de
sigle, même si ça ne veut pas tout dire, est tout de même
significatif : on y trouve les termes de professorat et
d’éducation. Autrement dit, on ne forme pas qu’au métier
d’enseignant, mais à tous les métiers de l’éducation. Et
quand on regarde l’histoire, c’est assez logique.
« On ne forme pas qu’au métier
d’enseignant, mais à tous les métiers
de l’éducation »
Selon les parcours, tous les étudiants ne doivent
pas suivre les mêmes cours en seconde année.
















